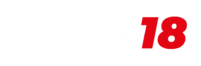Grands formats — Lorsque le médecin-chef Brigade, le médecin-chef des services Stéphane Travers, échange avec un chef d’agrès VSAV, le caporal-chef Théo Del Rio, nous nous apercevons vite qu’ils parlent le même langage. Entretien croisé.
Pouvez-vous vous présenter ?
Caporal-chef Del Rio : je suis le CCH Théo Del Rio, j’ai sept ans de service. J’ai commencé ma carrière à Courbevoie à la 28e compagnie et cela fait maintenant quatre ans que je suis à Grenelle. Je suis caporal-chef depuis deux ans.
Médecin-chef Brigade Travers : médecin-chef des services Stéphane Travers, je suis médecin-urgentiste du service de santé des armées et j’ai eu la chance de pouvoir effectuer un parcours mixte entre BSPP et différentes autres unités militaires. Ma première affectation BSPP débute en 2006 en tant que médecin adjoint au sein de l’antenne médicale du 1er groupement. J’ai par la suite servi comme médecin-chef du 2e groupement d’incendie, médecin responsable de la section « plans de secours – NRBC » du bureau médecine d’urgence puis médecin-chef de la Brigade.
Qu’est-ce qui vous a donné envie, chacun à votre niveau, de vous spécialiser dans le secourisme ? Est-ce que le secourisme est une variante de la médecine ?
MCB : c’est en fait en découvrant puis en pratiquant le secourisme que m’est venue l’envie de débuter des études de médecine. Le secours et soin d’urgence à personne (SSUAP), puis la médecine d’urgence sont les maillons d’une même chaîne de secours. La survie de chaque patient dépend des actions réalisées à chaque niveau (CO, VSAV, AR, hôpital) et de la parfaite coordination globale.
CCH : pour ma part je suis entré à la Brigade après les attentats de 2015. Il n’y avait pas que la partie incendie qui m’intéressait, il y avait aussi toute la partie secours à victimes. Je voulais déjà prendre de l’expérience et m’aguerrir en tant qu’équipier et dès lors que je me suis senti prêt, je suis allé au PECCH. Le but étant de pouvoir gérer des interventions à ma manière et de façon humaine.
Si vous deviez résumer la mission du secourisme à la BSPP en une phrase.
CCH : c’est aider les gens. On est pas mal confronté à la misère sociale et/ou psychologique. C’est beaucoup plus large que l’idée que l’on s’en fait au début.
MCB : si je devais résumer en une seule phrase, ce serait « répondre aux détresses vitales, fonctionnelles et humaines au quotidien et en situation de crise ».
Vous ne vivez pas le secours de la même façon. L’un en planification, coordination et au sein des ambulances de réanimation. L’autre dans les VSAV. Quelles sont, selon vous, les différences dans vos approches ?
MCB : nos approches sont certainement complémentaires, tant sur le terrain que depuis le centre opérationnel. Chaque acteur contribue au même objectif, celui d’améliorer la survie des victimes et la qualité des secours préhospitaliers. L’opérateur du centre opérationnel puis le chef d’agrès du VSAV sont clairement en première ligne, ce qui fait la beauté et aussi la complexité de leurs métiers. Le médecin vient en appui ou en renfort lorsqu’un patient nécessite un diagnostic plus précis ou des gestes de médecine d’urgence.
CCH : en fonction des circonstances, on sera les yeux et les oreilles du médecin et de la coordination médicale. En fonction de ce que l’on va relever comme détresse vitale, on aura ou non une équipe médicale qui se déplacera. C’est de cette façon-là que l’on interagit.
Chaque maillon de la chaîne a été amélioré depuis la prise d’appel à l’admission hospitalière.
CCH Théo Del Rio
Est-ce que vous trouvez que les techniques et protocoles ont évolué ces dernières années ?
CCH : oui, on a eu de nouveaux équipements qui permettent une meilleure remontée d’informations pour la hiérarchie. Par exemple, les tablettes e‑FiBi1. Elles sont bien plus performantes que les papiers, car on peut prendre des photos, dessiner les blessures. Un petit peu de difficulté à la prise en main, mais au final, on a un gain de temps énorme.
MCB : les techniques et protocoles ont en effet évolué sur plusieurs décennies. Chaque maillon de la chaîne a été amélioré depuis la prise d’appel à l’admission hospitalière. On peut citer comme exemples les filières d’orientation des AVC vers l’IRM et les unités neurovasculaires, l’amélioration de la formation et du matériel pour les accouchements difficiles, les évolutions techniques et organisationnelles ayant permis de doubler en quelques années la survie des victimes d’arrêt cardiaque. Cependant, le fond de la mission reste le même et les évolutions technologiques demeureront toujours au service de l’humain.
Comment s’articule la collaboration entre un chef d’agrès et l’équipe médicale ?
CCH : notre rôle va être de préparer le terrain de l’équipe médicale. On va ouvrir les accès, préparer les dossiers médicaux et conditionner la victime de façon à ce que le passage de témoin se fasse dans les meilleures conditions. Une fois l’équipe médicale sur les lieux, on l’assiste et on l’aide pour l’évacuation de la victime.
MCB : la parfaite coordination entre maillons (prise d’appel — VSAV — coordination médicale — AR) est, en effet, cruciale et nous y avons collectivement beaucoup travaillé. La formation des médecins et infirmiers BSPP comprend des simulations en équipe avec un VSAV pour apprendre à travailler ensemble et les nouveaux outils comme e‑FiBi /e‑fom participent à la fluidité du partage d’information. Lors de la réanimation d’un patient en arrêt cardiaque, le scope et les différents matériels sont interopérables ce qui permet de gagner un temps précieux.
Vous venez de citer l’ACR, mais est-ce que vous avez un autre exemple de situation où la coordination entre le chef d’agrès VSAV et l’équipe médicale a été décisive ?
MCB : oui, bien sûr, j’en ai énormément. Une de nos chances au sein de la BSPP est de disposer, sous un même commandement, du centre d’appels, d’une coordination médicale, d’équipes secouristes et d’équipes médicales. Cette unicité permet d’être efficace au quotidien, d’innover en permanence et de nous adapter en situation de crise. Les exemples sont nombreux en cas de détresse vitale d’origine respiratoire, cardiaque, neurologique ou en traumatologie bien sûr. Dans ces situations, le moindre dysfonctionnement ou la moindre perte de temps à un moment de la chaîne se rattrape difficilement. A contrario, l’efficacité parfaitement coordonnée du VSAV, du centre opérationnel, de l’équipe médicale puis de l’hôpital permet d’optimiser les chances de survie.
L’autre approche complémentaire est l’envoi de SMS à grande échelle à des requérants pour « capter du retour d’expérience ».
MCB Stéphane Travers
Quelles sont les qualités essentielles pour être un bon secouriste ?
CCH : je dirais l’empathie, l’humanité et le sang-froid. Je crois que le plus important est de savoir prendre un pas de recul sur intervention. On nous le répète souvent en formation, mais c’est essentiel, car on a vite fait de prendre la mauvaise direction.
MCB : s’il faut en choisir trois, je dirais également l’humanité, car nos métiers sont profondément humains, au service des victimes. J’ajouterais l’intelligence de situation, car chaque intervention est bien sûr différente et il faut parfois beaucoup de discernement, de finesse pour identifier quelles seront les meilleures solutions sur le terrain. En troisième, je dirais la rigueur. Si certaines détresses sont « évidentes », d’autres sont en effet beaucoup plus délicates à repérer dans le flux quotidien de nos interventions. Une victime peut s’aggraver brutalement ou présenter une pathologie beaucoup plus grave que son état ne le laisse penser. La rigueur, la conscience professionnelle et l’application systématique des procédures sont les seules façons d’éviter « l’effet tunnel » et de ne pas se laisser piéger.
Pour conclure, voulez-vous dire un mot sur la démarche qualité SSUAP ?
MCB : les formations, l’entraînement, les travaux de retours d’expérience ou encore l’analyse des évènements désirables ou indésirables ont pour objectif de garantir la qualité de nos réponses opérationnelles en SSUAP et dans bien d’autres domaines. Un des enjeux à l’échelle Brigade est d’assurer la fluidité du partage d’expérience pour que chaque chef d’agrès et chaque équipier puisse s’enrichir de ce que d’autres ont appris sur une intervention difficile ou particulière.
Deux actions nouvelles ont ainsi été débutées depuis quelques mois. La première est l’analyse aléatoire et de bout en bout d’un certain nombre d’interventions pour regarder en détail ce qui a été bien fait, ce qui a éventuellement posé des difficultés et identifier ce que nous pourrions collectivement améliorer encore en termes de procédures, de formations, de matériel, etc. Les analyses de chaque maillon et des interactions entre eux sont complétées par le regard et les avis du chef d’agrès VSAV puis de la victime si celle-ci peut être contactée. L’autre approche complémentaire est l’envoi de SMS à grande échelle à des requérants pour « capter du retour d’expérience ».
CCH : l’idée des QR codes2 n’était forcément pas très bien accueillie par tout le monde. Mais pour l’instant on n’a pas eu de répercussions négatives et je pense que ça ne peut qu’améliorer les choses.
MCB : ce que tu dis est très intéressant, car il est important que la démarche soit bien comprise. Le seul objectif est de gagner encore en fiabilité collective. Les premiers retours sont d’ailleurs excellents. Ils ont permis à la fois de recueillir la satisfaction et la reconnaissance d’une très grande majorité des requérants et victimes, tout en identifiant des leviers pour améliorer ou consolider encore certains aspects de nos interventions.
1 : Fiche bilan dématérialisée 2 : Dispositif de traçabilité de l’intervention
À LIRE AUSSI…
v